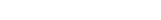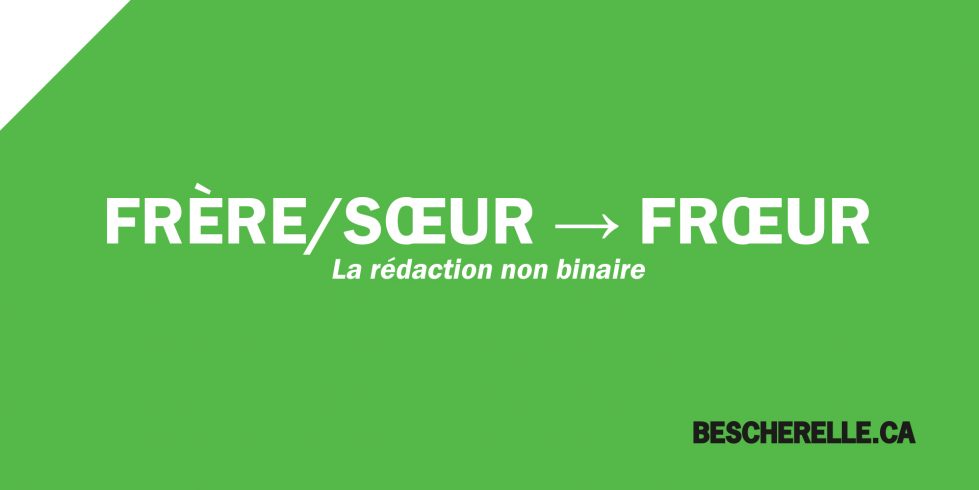Parmi les 36 sons du français, on trouve des consonnes occlusives et fricatives (p, t, k, b, d, g, f, s, ʃ, v, z, ʒ), mais aussi des consonnes nasales. Celles-ci sont prononcées en abaissant la luette afin de laisser passer l’air par le nez. Le son [m] est prononcé avec la position bilabiale (les lèvres ensemble), comme pour prononcer un [b], mais la luette n’est pas relevée. Le son [n] est un son nasal associé à [d], alors que le son [ɲ], comme dans saignant, correspond à la position buccale du son [g], à la différence que l’air traverse la cavité nasale.
Un phénomène appelé l’affrication consiste à prononcer une consonne occlusive en la faisant suivre immédiatement d’une fricative. En français québécois, on prononce les consonnes affriquées [ts] et [dz] devant i et u : tic [tsik], dit [dzi], tu, du. …